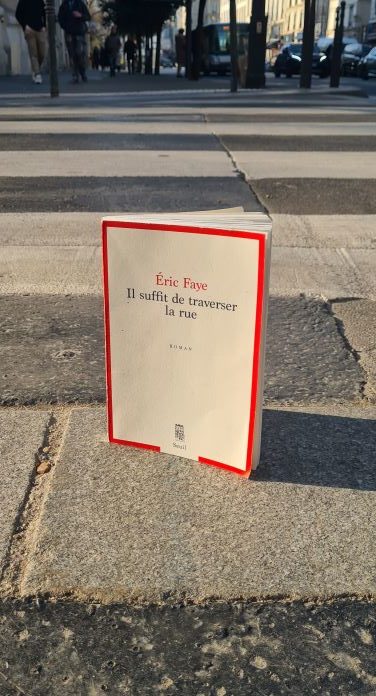Dans « Il suffit de traverser la rue », Eric Faye raconte comment la mondialisation démantibule patiemment une agence d’information; et comment aussi, dans sa deuxième partie, les propositions de reconversions professionnelles se dissolvent en faisant des bulles.
« Puisque j’allais entamer une nouvelle existence comme rebut du monde du travail, pourquoi faire semblant d’en chercher » ? Face à ma mine abasourdie, Doumenc a enfilé son plus large sourire pour me livrer ses pensées : « Ca fait toujours ça de moins dans les statistiques du chômage, c’est tout. Ces formations à la noix, ce sont des crèches pour hommes, ni plus ni moins… Pendant un an, tu es missing in action : tu ne fais plus partie de la population active, mais tu restes miraculeusement absent des statistiques de Pôle emploi, et la boîte te verse encore ton salaire. Tu as glissé dans un espace intermédiaire mon vieux, et la boîte te verse encore ton salaire. Tu as glissé dans un espace intermédiaire, mon vieux, dans les limbes du monde moderne. »
J’ai mis un certain temps, voire un temps certain, mais il n’y a pas mort d’écrivain puisque l’ouvrage est paru début janvier, pour ouvrir le livre d’Eric Faye. Le titre était pourtant alléchant mais il ne montait pas au ciel en volutes de roman. Ca ressemblait plutôt à un pamphlet. Ce mot, roman, féérique à sa manière, était pourtant dûment signalé en couverture mais ce monde nous déconcentre, nous disperse. On voit trop, à toute vitesse, et on ne voit plus.
Voilà, c’est fait, j’ai lu. Et ce roman est appelé à figurer au-dessus de mon lit dans ce que j’ai nommé « la cité des livres qui comptent ».
Son sujet ? Aurélien Babel (Babel !!!), 57 ans, plutôt bien payé par Mondo News, une agence de presse au rayonnement international qui l’emploie rue Montmartre à Paris, est devenu l’archétype du « mauvais cholestérol » des nouvelles habitudes économico-mondialistes. Il coûte trop cher pour ce qu’il rapporte. A l’instar du titre d’un immortel western, son nom est désormais devenu Personne.
Aurélien a une femme, Adèle ; une belle situation comme on dit dans nos campagnes et nos beaux quartiers. L’un de ses deux fils aussi. L’autre est son opposé complet ; le vagabond de la famille mais un vagabond qui fait du surplace. L’avantage est qu’il ne demande rien à personne. A commencer par l’argent.

Aurélien n’est pas un aventurier du journalisme. Jamais il ne s’est senti mû par l’envie d’aller voir du pays. Mettre en ligne les enquêtes de ses camarades suffit à son bonheur. Il a publié une plaquette de poèmes. Au rendez-vous annuel des évaluations imposées par la grande direction sise à Seattle et de plus en plus sophistiquées en matière de perversion masquée, cette sympathique activité ne peut guère provoquer autre chose qu’une vague stupéfaction mâtinée de méfiance. Je sais de quoi je parle, c’est un travers que j’ai aussi. Lors d’un dîner guindé où aucun gosier ne risquait de faire fausse route, mon voisin se sentant contraint de m’adresser la parole après avoir consacré la moitié de la soirée à deviser avec un prestigieux invité, me demanda sans préliminaires : « il paraît que vous écrivez des poèmes ? Et ça vous rapporte quoi ? » Je lui répondis que ça me rapportait plein de jolies filles. (*)
Mais revenons à mon enthousiasme pour ce livre d’Eric Faye, lauréat en 2010 du Grand Prix du roman de l’Académie française pour « Nagasaki ». Eric est un amoureux du Japon. Il n’est pas mauvais de rappeler, pour mieux cerner le sujet qui nous occupe ici, quelques-uns des titres de ses ouvrages qui délivrent en choeur un message subliminal : au hasard en en vrac, « Dans les laboratoires du pire », « Le Syndicat des pauvres types », « Billet pour le pays doré », « L’homme dans empreintes », « Il faut tenter de vivre », « Le bureau des jours perdus »… « Il suffit de traverser la rue » ne dépare pas dans le paysage et construit sur la punchline désormais immortelle d’Emmanuel Macron une fusée à deux étages. Sa trajectoire décrit à la perfection, avec un sens éprouvé de la dissection douce, l’art et la manière de mettre une entreprise d’information en coupe réglée d’un monde soumis à la dictature de l’argent rentable. Mais un monde qui court aussi à sa perte à la vitesse de la fonte des glaces. N’empêche, Faye, dont l’humour affiché est la parfaite illustration de la politesse du désespoir, s’appuie sur la méticuleuse observation de ses semblables, à commencer par lui. Tout le monde comprend bien, ou ne veut pas comprendre, qu’il y a une couille dans le potage. Une Cassandre se fait moquer. Jusqu’à ce que la marche des choses lui donne raison. Les agences satellites se font dégommer les unes après les autres comme des ballons chinois, sous l’effet d’une restructuration qui carbure à moindre coût avec de jeunes troupes déculturées.

La seconde partie coupe le poil avant qu’il ne repousse. C’est celle d’une croyance en une reconversion professionnelle dans les locaux de la société Opportunities, laquelle est sise tour Farheinheit. Dans les locaux de de Mondo News, le bras armé, au sourire de velours, du dégraissage général, s’appelle Enguerrand Audet. Dans ce chant du cygne de nos désertifications urbaines, Martineau est un anti-héros moderne, c’est-à-dire une écorce d’orange flottant (est-ce que les écorces d’orange flottent ? je n’en suis pas du tout certain, mais alors pas du tout) sur un océan de fausse solidarité. Il parle comme un agent double utiliserait l’encre sympathique. Avec lui, les espoirs et les impatiences de ses interlocuteurs font du yoyo jusqu’à l’épuisement. « S’il est une chose que j’ai laissée chez moi à l’issue de ces mois hors du commun, c’est ma naïveté » constate Aurélien Babel. C’est page 225. Il en reste quelques-unes. Aurélien saura-t-il rebondir ? Ou gagnera-t-il les entrailles de la tendre et magnifique Lozère pour enseigner le macramé ? Vous le saurez en dansant jusqu’au bout sur les lignes de Faye.
(*) C’est pénible cette manie de certains auteurs d’articles à toujours tout rapporter à eux.
« Il suffit de traverser la rue », de Eric Faye, éd. Seuil, 272 pages, 19,50€